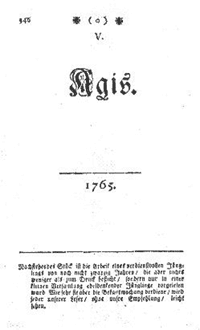Enfance et jeunesse à Zurich
1746-1768
Johann Heinrich Pestalozzi naît le 12 janvier 1746 au domicile de ses parents dans le « Oberer Hirschgraben » à Zurich. La famille avait obtenu les droits à la citoyenneté de cette ville au milieu du XVIème siècle, lorsque leur ancêtre, Johann Anton Pestalozzi, s'y était établi après avoir quitté Chiavenne. À l'origine, c'était une famille commerçante sans fonction publique. C'est après de études de théologie qu'Andreas Pestalozzi, le grand-père de Johann Heinrich, devient Pasteur à Höngg près de Zurich, il sera ainsi le premier de la famille à exercer une fonction uniquement réservée aux citoyens de la ville.

Les premières années de la vie de Pestalozzi sont marquées par de grandes turbulences familiales: en l'espace de huit ans de mariage, sept enfants voient le jour mais quatre d'entr'eux meurent en bas âge. Pestalozzi n'avait que cinq ans lorsque son père Johann Baptist Pestalozzi (1718-1751) s'éteint. Pour une famille zurichoise, la situation financière était, déjà du vivant de son père, plus que précaire puisque ce dernier, en tant que « Chirurgus », n'arrivait pas à nourrir sa famille. Après sa disparition, la situation s'aggrave encore. Cependant, la mère décide de ne pas déménager avec les petits survivants à Richterswil, sur la rive gauche du lac de Zurich pour aller rejoindre des membres plus fortunés de sa famille, car s'il est vrai qu'ils peuvent subvenir aux besoins économiques de la famille en difficulté, sa parenté ne possède toutefois pas la citoyenneté zurichoise. C'est bien à cause de meilleures chances de formation pour ses enfants et d'une plus grande offre au niveau des écoles, que la famille, tout de même privilégiée par le fait de détenir la citoyenne de Zurich, choisit d'y rester. La situation de dénouement financier conjuguée aux expériences traumatiques de la famille contribuent à une sollicitude anxieuse de la mère et de la fidèle servante de la maison, Barbara Schmid. Pour Pestalozzi, ses années d'enfance seront seulement remplies d'ennui et d'expériences très limitées à cause d'une extrême surprotection. En 1804, il décrit rétrospectivement ce vécu-là dans une lettre adressée à Hans Konrad Escher (von der Linth):
« Mes années de jeunesse m'ont privé de tout ce qui permet à l'homme de poser les premiers fondements en vue d'un usage civil. J'ai été élevé comme une brebis qui n'avait jamais le droit de quitter le bercail. Je ne pouvais jamais aller rejoindre les enfants de mon âge dans la rue, je ne connaissais aucun de leurs jeux, aucun de leurs exercices, aucun de leurs secrets. Bien entendu, parmi eux, j'étais gauche et je leur semblais ridicule. De sorte qu'ils me surnommèrent, dans ma neuvième ou dixième année, le « Heiri Wunderli von Torliken » (on pourrait le traduire par le « farfelu d'Hurluberlu » n.d.l.t.) ( 29, p. 104).
Et dans un autre contexte, il poursuit ainsi au sujet de son enfance:
« Les expériences ordinaires et quotidiennes, par lesquelles la plupart des enfants - que ce soit à la maison ou en dehors - en saisissant et manipulant des milliers d'objets divers acquièrent les compétences nécessaires à la vie et ce faisant se préparent et deviennent habiles, presque sans le savoir ou le vouloir, tout cela m'a complètement manqué. Puisque dans ma chambre d'enfant il n'y avait pratiquement rien à portée de main pour m'occuper de manière intelligente et enrichissante, et qu'avec ma vivacité j'abîmais et détruisais, sans le vouloir, tout ce qui me tombait sous la main, on a cru préférable pour moi, pour mon bien, de faire en sorte que je prisse dans mes mains aussi peu que possible, afin d'en endommager le moins possible. « Ne peux-tu pas rester tranquille ? Ne peux-tu donc pas tenir tes mains tranquilles ? C'était l'ordre que je recevais bientôt à tout moment. Mais c'était aller contre ma nature, je ne pouvais pas rester tranquille, je ne pouvais pas tenir mes mains tranquilles, plus je devais le faire et moins je le pouvais. Lorsque je ne trouvais plus rien, je saisissais une ficelle et je l'entortillais aussi longtemps entre mes doigts jusqu'à qu'elle ne ressemblât plus à une ficelle. Chaque feuille, chaque fleur qui tombait dans mes mains, connaissait le même sort. Imagine le cas d'une mécanique qui bât son plein et dont on embrouillerait et obstruerait soudainement l'élan de sa force motrice, tu aurais ainsi le tableau des influences de ma condition sur le cours de mes forces cherchant développement et occupation. Plus elles étaient freinées, et plus elles apparaissaient confuses et violentes, là où elles voulaient ou pouvaient se montrer. »
Pestalozzi fréquente à Zurich, sa ville natale, toutes les écoles qui, à l'époque étaient accessibles gratuitement à tout jeune citoyen intelligent de cette ville. Son parcours scolaire l'emmène à travers la Schola Carolina du Großmünster vers des études au Collegium Carolinum, une école ayant les caractéristiques d'une Haute école et dont les enseignants faisaient rayonner l'esprit des Lumières à Zurich, voire en Suisse. Au début, Pestalozzi aspire à devenir Pasteur comme son grand-père puis il entreprend des études de Droit. Parmi ses professeurs il y a Johann Jakob Bodmer (1698-1783) dont la renommée allait bien au delà des frontières de la ville et du pays.
Un groupe d'étudiants fort doués entourait Bodmer et se réunissait un soir par semaine dans une salle de la corporation des tanneurs. Ils se faisaient donc appeler la "Société Helvétique du Gerwe" (Gerwe étant une ancienne forme du mot Gerbe qui signifie tanneur) mais ils étaient également connus sous le nom de « Patrioten » (les patriotes) et publiaient leur propre hebdomadaire « Der Erinnerer » (le Mémorial). Dans le cercle des Patriotes on discutait les idées des philosophes classiques et modernes : Platon, Titus, Livius, Salluste, Cicéron, Comenius, Macchiavel, Leibniz, Montesquieu, Sulzer, Hum, Schaftesbury, Lessing mais surtout celles de Jean-Jacques Rousseau. À travers eux, les jeunes étudiants apprenaient à connaître les grands idéaux de la vie et faisaient des projets de société avisés qu'ils comparaient ensuite avec la réalité environnante de leur ville : à Zurich, une poignée de familles patriciennes détenait le pouvoir et celui qui émettait des critiques à leur égard, se manifestait contre l'arbitraire des puissants ou contestait le droit en vigueur, devait s'attendre à la persécution et l'extradition. Les paysans des villages environnants étaient sommés de vendre leurs produits à la ville, au prix qu'elle leur fixait, et en même temps, ils étaient obligés de couvrir une bonne partie de leurs besoins en faisant leurs achats en ville. Le vrai commerce ou la grande activité artisanale n'étaient autorisés qu'à certains citoyens privilégiés. De ce fait, les fonctions ecclésiastiques et publiques comme le pastorat, le tribunal de justice ou l'administration ne revenaient de droit qu'aux citoyens de la ville de Zurich. La liberté d'expression était soigneusement limitée par une censure des plus strictes. Au cours de leurs rencontres hebdomadaires, les Patriotes dénonçaient haut et fort la gouvernance autoritaire de la classe dirigeante qui réagissait irritée. Mais les étudiants ne se laissaient pas impressionner pour autant, car même les « grands seigneurs » n'osaient pas inquiéter une personnalité, aussi prestigieuse en deçà des frontières, comme l'était Bodmer. Sans aucun doute, l'enthousiasme de Pestalozzi pour les us et coutumes purifiés dans la société et l'État, son penchant pour une réforme et pour un gouvernement juste, son goût pour les idées de liberté, de séparation des pouvoirs ou celles qui réclamaient l'abolition de l'exploitation de la campagne et de ses habitants ont contribué non seulement à le rendre impopulaire mais à compromettre très tôt, et de manière durable, ses chances de décrocher une fonction publique - fonction qui lui aurait pourtant correspondu d'office à cause de sa citoyenneté zurichoise.
Les premiers écrits de Pestalozzi qui ont été conservés à ce jour, proviennent de cette époque là : « Agis « et « Wünsche » (Voeux).
« Agis » est le premier écrit conservé de Pestalozzi. Il paraît en 1765 dans le Journal de Lindau pour échapper à la censure zurichoise. La politique de réforme d'Agis, roi de Sparte, échoue face à la résistance de l'aristocratie nantie et dirigeante. Avec une subtile ironie Pestalozzi établit des parallélismes avec la situation de Zurich, tout en disant qu'il ne s'agit « aucunement d'une satyre sur nos conditions ».
« Wünsche » ( Vœux ), une suite de notes aphoristiques tirées de l'hebdomadaire « Der Erinnerer » (Mémorial) de 1766, met également en évidence les penchants contestataires ou critiques de Pestalozzi. L'écrit commence ainsi :
« Un jeune homme qui, dans sa patrie, fait une aussi petite figure que moi, n'ose ni critiquer, ni améliorer les choses, car tout cela reste en dehors de sa portée. On me le rappelle presque au quotidien ; mais me sera-t-il permis au moins de faire des vœux ? - Oui, qui pourrait m'en empêcher ou m'en savoir mauvais gré ? Je veux donc faire des vœux, et les laisser par écrit aux yeux des lecteurs ; et pour celui qui viendrait à se moquer de mes vœux, voici mon vœux pour son bon rétablissement » (1, p. 25)
C'est surtout Jean-Jacques Rousseau qui impressionnait les étudiants zurichois. Le « Contrat Social » et « l'Emile » parurent en 1762, les deux œuvres éveillaient chez-eux l'idéal d'une vie naturelle, vertueuse et libre. La vie du citadin leur semblait pervertie, dépravée et artificielle ; le paysan, au contraire, vivait – du moins dans leur imaginaire – en relation simple, énergique et étroite avec la nature. Chez Pestalozzi, ces idées s'ancrèrent au plus profond de lui et le poussèrent à vouloir aider les pauvres et ceux qui étaient privés de leurs droits à la campagne. À Höngg, dans la paroisse de son grand-père, qu'il visitait souvent comme enfant, il avait pu observer de près, depuis la perspective d'un enfant citadin privilégié, l'oppressante condition d'une population paysanne privée d'instruction et de ses droits. Alors, déjà à 21 ans il arrête prématurément ses études et choisit de devenir « paysan ». Comprenons par là, non pas un agriculteur, mais le maître d'un domaine agricole qui aurait dû permettre avec sa production, de subvenir aux besoins d'un citadin cultivé et intéressé à toute sorte de choses. Mais Pestalozzi manquait, à cette fin, de toutes les compétences, surtout de celles nécessaires à l'agriculture et la paysannerie. Alors il commença en 1767, auprès de Johann Rudolf Tschiffeli [1] dans le Kirchberg bernois, un apprentissage agricole, afin d'apprendre les techniques les plus modernes d'horticulture et d'agriculture.
L'agriculture se trouvait, suite aux Lumières et aux progrès des sciences naturelles, à un point de bouleversement fondamental : abandon de l'agriculture de rotation triennale en faveur d'une exploitation plus intense des terres, utilisation précise des engrais et renoncement à l'année de jachère. Tschiffeli était un pionnier dans l'application de ces techniques, et Pestalozzi voulait suivre ses pas. La décision de Pestalozzi fût inspirée par les fondements philosophiques de l'agriculture : Si le mercantilisme, en tant qu'économie de l'absolutisme français, considérait les réserves de métaux précieux comme étant la base du bien-être socio-économique, cette théorie fut contestée par les physiocrates adeptes de Rousseau. Selon ce dernier, le bien-être de la société se fondait sur le fruit naturel de la terre, et celui-ci dérivait d'une agriculture saine, pour cette raison la priorité de la politique socio-économique devait être la modernisation de l'agriculture.
La Physiocratie exigeait l'abolition de l'économie contrôlée par l'État (manque de liberté commerciale et professionnelle ; contrôle de la production par les corporations) et l'encouragement de l'économie privée, pour arriver - par un « jeu naturel entre les forces » - à un équilibre naturel dans le secteur économique. La satisfaction optimale des besoins économiques du peuple devra résulter d'une libre compétition de l'économie de marché et d'un libre commerce international.
Si Pestalozzi, déjà à 21 ans, cherchait à avoir une occupation pratique prometteuse et rentable économiquement, celui-ci avait - mis à part l'exaltation en vogue pour la vie paysanne et le besoin de venir en aide, par le bon exemple, à la population paysanne - une raison plus profonde et solide : Il était amoureux, il voulait se marier et cherchait un moyen de subvenir correctement aux besoins de sa future famille. Son amour pour Anna Schulthess, âgée alors de 29 ans, commença en 1767 à la mort de leur ami commun Johan Kaspar Bluntschli surnommé Menalk et qui, à 23 ans, succomba à une maladie pulmonaire. Menalk, par son exemple, avait encouragé ses amis du cercle des Patriotes à travailler. Sentant sa mort approcher, Bluntschli voyait dans son ami, de deux ans plus jeune que lui, celui qui réaliserait ses propres idéaux. Pestalozzi le confirma en s'engageant corps et âme à améliorer les conditions sociales et politiques, même au péril de sa propre vie. La mort de leur ami commun les bouleversa profondément et, dans la douleur de cette perte, Pestalozzi se sentit proche d'Anna Schulthess. Sans s'en apercevoir, ce deuil commun alluma chez Pestalozzi sa flamme amoureuse qui avec la fugue d'un volcan menaçait de l'engloutir. Ainsi peut-on lire dans une des premières lettres à sa future femme :
« Mademoiselle! J'essaie en vain de retrouver mon calme. Je le vois, mes espoirs sont perdus. Mon châtiment sera de payer mon étourderie par un chagrin éternel. J'ai osé vous étonner, vous parler, vous écrire, imaginer, sentir vos propres sentiments et vous les dire. J'aurais dû connaître les faiblesses de mon coeur et éviter ces dangers où disparaît chaque espoir. Que dois-je faire ?; dois-je me taire et accabler mon coeur d'un chagrin muet, ne pas parler et n'attendre aucun espoir, aucun soulagement pour ma souffrance ? Non ! Je refuse de me taire, il y aura un soulagement pour moi si je sais que je n'ai pas droit à l'espoir. Mais que dois-je espérer ? Non ! Je n'ai pas le droit à espérer quoi que ce soit ! Vous avez vu Menalk, et l'homme que vous pouvez aimer doit lui ressembler. Et moi! Qui suis-je ? Quelle différence ! Comme je sens le coup mortel porté par ces mots cruels : que je ne ressemble pas à Menalk, que je ne vaux rien à vos yeux ! Je le sais ; je mérite cette réponse, je vais l'accepter ; je n'attends rien d'autre. [...] Toute la journée je reste à rien faire, sans travailler, sans penser, gémissant toujours et partout, cherchant une distraction sans l'y trouver, je saisis votre lettre, je la lis, la relis, je rêve, j'espère, puis je reperds tout espoir, j'accable une mère tendre et angoissée avec les explications d'une maladie que je ne connais pas, je fuis le contact avec mes amis, je fuis la gaîté du jour, je m'enferme dans la chambre la plus isolée et obscure, je me jette sur le lit où je ne trouve ni sommeil ni paix ; je me mine moi-même. Toute la journée je ne pense qu'à vous, à chacune de vos paroles, à chaque endroit où je vous ai vue. J'ai perdu toutes mes forces, toute ma sérénité intérieure et je ne dépens que de vous. Oh ! Comme je dois vous sembler petit, méprisable au moment où j'essaie d'attirer envers moi votre haute estime. Oh, si vous n'avez pas perçu mes sentiments, oh ! Si vous ne les avez pas imaginés, quel danger encourra votre amitié envers mon sensible, oh ! Mon trop sensible cœur!- Vous m'avez confié vos sentiments pour Menalk ; j'éprouvais les mêmes avec vous ; vous écoutiez les miens et vous y retrouviez les vôtres ! Qu'ai-je fait ? Qu'avez-vous fait ! Mon estime pour vous s'est transformée maintenant en l'énorme passion de l'amour. Chaque jour, chaque heure, chaque instant elle s'accroît. Ce n'était pas assez pour m'accabler que de perdre Menalk: je dois éprouver un double chagrin, deux fois sans aucun espoir. […]
Je vous ai déjà écrit trois fois et par trois fois j'ai déchiré la lettre ; celle-ci, je ne veux plus la déchirer. Je considère que c'est mon devoir de parler maintenant, car je ne pourrais plus rien passer sous silence sans mettre en danger ma santé et ma condition psychique. Vous connaissez mon cœur ; vous savez combien il est éloigné de toute hypocrisie. Vous connaissez ma timidité ; vous savez certainement combien cela m'a coûté de me décider à franchir ce pas. Je ne veux plus m'excuser davantage.
Bonté divine, soyez-moi propice, pour l'attente calme de l'importante réponse. Et vous, excellente Schulthess Schulthess Schulthess ! Dépêchez-vous de me l'envoyer. Oh heures, instants à attendre la décision ! Mon cœur bat ; comment vais-je le supporter. Mon bonheur, mon calme, l'avenir, moi, mon être entier dépend de cette réponse.
Dépêchez-vous, je vous en conjure à genoux, de répondre à vôtre P. » (1, p. 3-5)
Anna et Heinrich étaient très différents : Elle était une beauté citadine, habituée à avoir suffisamment d'argent, intelligente et instruite, pieuse, subtile et sensible, mais elle imposait aussi un côté plutôt froid et distant, et tout comme Pestalozzi, elle avait un penchant coléreux – Pestalozzi, lui, était corporellement disgracieux, maladroit à plus d'un égard, mais à d'autres, il était très doué. Il était empli de grands projets pour améliorer le monde, mais sa condition de pauvre et le fait d'être le fils d'une veuve ne lui permettaient pas d'avoir une voix dans la ville de Zurich. Aussi, aux yeux d'Anna, il y avait entre elle et Pestalozzi une différence de condition évidente, ce pourquoi, dès le premier contact, elle fit pression pour maintenir le secret autour de cette liaison. Lorsque les parents Schulthess eurent vent des intentions de Pestalozzi, ils le chassèrent aussitôt et lui interdirent les visites.
Les jeunes ne pouvaient alors que se retrouver en cachette et s'écrire tous les jours ou du moins chaque semaine. Entre le printemps 1767 et la date de leur mariage, en septembre 1769, il existe encore 468 lettres représentant environ 650 pages [2]. L'amour passionné de Pestalozzi pour Anna, la résistance de celle-ci au commencement et son accueil, en général plutôt froid, puis la lente éclosion de sa propre passion amoureuse, l'épanouissement de part et d'autre d'une affection pleine de poésie, humour et tendresse, puis leur lutte commune pour la vérité et la vertu et leur combat pour défendre leur amour face à l'opposition des riches parents Schulthess avec toutes les humiliations et les blessures que cela a supposé – rien de tout cela ne peut laisser indifférent celui qui lit ces lettres aujourd'hui. Elles dévoilent avec force la richesse intérieure de Pestalozzi, sa grande tendresse de cœur, ses soucis et sa propre vertu mais aussi ses connaissances et son grand dévouement pour le peuple. Les réflexions qui se trouvent dans ces lettres sont des témoins autobiographiques d'une rare valeur.
Dans une lettre explicite du jeune Pestalozzi, âgé de vingt et un ans, dans laquelle il se caractérise sans ménagement, dévoile, sans rien omettre, ses valeurs, et ébauche ses rêves par rapport à la vie, on reconnaît des traits fondamentaux qu'on retrouvera plus tard dans sa vie : Il veut servir sa patrie sans égards envers sa femme ou ses enfants, il met son empressement et son irréflexion dans tout ce qu'il entreprend, il construit avec l'aide de la parenté aisée d'Anna, il veut mettre en œuvre les préceptes éducatifs de Rousseau et ne pas laisser que ses fils deviennent des citadins désoeuvrés, et il affiche des tons dépressifs et mélancoliques dans lesquels il évoque ses faiblesses, sa maladie et sa mort prochaine (conf. 1, p. 25-35)
Aussi, dans des lettres postérieures il s'enthousiasme pour une vie à venir, rurale et commune et si ses images rêveuses et idylliques se révélaient aussi un jour n'être que des illusions, elles dévoilent ainsi ses intentions sociales qui fondent la base de son choix professionnel :
« Mon amie, je me réjouis de savoir que vous considérez que la ville n'est pas un endroit propice à l'épanouissement de nos desseins. Mon refuge doit rester fermement à l'écart de cette convergence du vice et de la pauvreté. Dans ce refuge solitaire la patrie doit m'occuper davantage que dans le tumulte de la ville. Lorsque je me trouve à la campagne et que je vois le fils d'un compatriote, qui promet une grandeur d'âme et qui n'a pas de pain, alors je le conduis par la main et fais de lui un citoyen, et il travaille et mange du pain et du lait et il est heureux. Et lorsqu'un jeune a un geste exemplaire et qu'en contrepartie il reçoit la haine de sa famille ingrate, il doit trouver chez-moi du pain, tant que j'en ai ! Oui, avec plaisir, ma bien aimée, je bois de l'eau et je donne du lait puisque j'aime, que ce noble d'âme voie combien je l'apprécie. Ma chère, c'est lorsqu'il me verra boire de l'eau qu'il m'aimera. Vraiment, ma chère, pour servir nos concitoyens nous devons limiter nos besoins autant que la bienséance et le goût le permettront. Combien, ma chère, je pourrais m'entretenir ici de ces jours plaisants et de la joie des enfants à venir, de l'agréable surprise de mes amis. Mais je me tais et je vous dis encore ceci, il se peut que les circonstances aidant, je sois appelé à l'avenir à quitter ce domaine. En tant qu'honnête citoyen, je ferai toujours pour ma patrie ce qui est de mon devoir et, mon amie, je ferai en sorte que la réalisation de chacun de nos devoirs vous soit agréable. » ( 1, p. 60-61)
Pendant des mois, Anna hésite, examine les faits, attend jusqu'à être sûre de son amour et la lettre de délivrance est la première qu'elle date: 19 août 1767.
Peu après, en septembre 1767, Pestalozzi quitte Zurich pour entreprendre son apprentissage agricole. Ses lettres seront remises en cachette à Anna par l'entremise de ses frères et d'amis communs. Il devient toujours évident que l'apprentissage de son métier le prépare à une activité pour le bien du peuple et « que le but ultime de son entreprise vise le bonheur d'un grand nombre de ses concitoyens » (1, p. 241). Après neuf mois d'apprentissage seulement - celui-ci est suspendu par une pause hivernale de trois mois - Pestalozzi considère qu'il est achevé, il quitte sa formation chez Tschiffeli, retourne à Zurich et commence sa carrière d'entrepreneur agricole.